de mars 2001
| Newsletter
d'obstétrique de mars 2001 |
Voici la newsletter d'obstétrique de mars 2001
| Faut-il faire un dépistage systématique
de l’hépatite C en cours de grossesse ? : Revue de la littérature par Jacques SALVAT.
Nouveautés sur gyneweb et sur le web
|
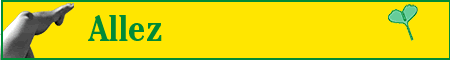
Cliquez ici pour
les mentions légales
Faut-il faire un dépistage systématique de l’hépatite C en cours de grossesse ?Jacques SALVAT*, Marie-Hélène SCHMIDT**, Muguette GUILBERT*, *Service de Gynécologie oncologique et mammaire - Hôpitaux du Léman 74203 Thonon (France).
INTRODUCTIONL’hépatite C est un problème de Santé publique et la Gynécologie-Obstétrique est concernée. La prévalence de l’hépatite C atteindrait dans le monde, d’après l’OMS, 3% de la population -Ebeling 1998-(16). L’incidence annuelle de l’hépatite C a diminué dans les pays développés. Les méthodes de prévention au cours des transfusions (en France, chez les donneurs de sang depuis le 1° mars 1990) et l’institution des précautions chez les toxicomanes par injection ont contribué à diminuer l’incidence de l’hépatite C. L’incidence annuelle des formes aigues aux USA a été divisée par 10 depuis 20 ans –Wong 2000-(63). Le réseau sentinelle des médecins généralistes, en France a dépisté 2 fois moins de nouveaux cas (21.000 nouveaux patients en 2000 au lieu de 45.000 en 1998 -Massari-(34 ). Le problème reste cependant important. Aux USA, l’hépatite C serait 4 fois plus fréquente que l’infection par HIV –Wong 2000- ( 63 ). En France, l’hépatite C s’est développée depuis plusieurs années. Elle a fait l’objet d’un rapport en 1997 –Micoud 1997- (( 37). En France, en 2000, le ministère évalue à 600.000, les personnes ayant eu un contact viral avec le virus de l’hépatite C ( VHC). Une hépatite active à VHC affecterait 1,2% des français (500.000) et parmi les patients infectés à VHC, seul un sur 5 serait reconnu (90.000). Les prévisions du Center of Disease Control (CDC) ont estimé que la mortalité par hépatite C deviendra 2 à 3 fois supérieure dans les 10 à 20 ans –Wong 2000- (63). Pour l’OMS, l’hépatite C (en même temps que l’anémie, le paludisme, le SIDA) serait une des causes indirectes de mort maternelle dans les pays en voie de développement –Prual 1999- (47 ). L’hépatite C pose de nombreux problèmes thérapeutiques. Un rapport du National Health Service (NHS) de mars 1998 n’acceptait pas le dépistage systématique de l‘hépatite C chez les toxicomanes par injection ou les consultants en MST, compte-tenu des difficultés d’application de la surveillance et du traitement dans la population concernée. La surveillance par ponction hépatiques répétées, n’est pas dénuée de complications propres (hémorragies, hématomes, péritonite biliaire et même anévrysme artério-veineux…). La non compliance atteignait 45 % chez les toxicomanes et 69% chez les multipartenaires sexuels… Une conférence européenne de consensus réfutait le dépistage systématique au cours de la grossesse – Conférence de consensus de1999 – (12). Des éléments nouveaux sont-ils intervenus pour modifier cette opinion ? Quels arguments sont en faveur d’un dépistage systématique ? Les tests de dépistage sont-ils performants et quels tests utiliser ? La prévalence de l’infection par l’hépatite C est-elle suffisante pour rendre efficace le dépistage dans une population de jeunes femmes en âge de procréer ? Quels sont les facteurs de risque de l’infection par hépatite C ? L’assistance médicale à la procréation est-elle possible ? Quels sont risques de la méconnaissance et de l’absence de traitement de l’hépatite C pour la femme enceinte ? Quel est le risque de transmission verticale à l’enfant ? La césarienne doit-elle être privilégiée ? Quels sont les risques de l’hépatite C pour l’enfant ? Quels traitements sont efficaces et autorisés chez la femme enceinte, le nouveau-né, l’enfant ? A quelle période le dépistage est-il préférable ? La rentabilité d’un tel dépistage est-elle réelle ? Le dépistage comporte –t-il un éventuel bénéfice pour l’entourage de la patiente et le personnel soignant ? METHODENous avons parcouru la littérature et interrogé Medline avec les mots clefs suivants : hépatite C et grossesse, amniocentèse, prévention, traitement. Compte-tenu de la rapidité d’évolution des concepts, nous avons limité nos recherches bibliographiques aux trois dernières années. RESULTATSArguments en faveur d’un dépistage systématique en cours de grossesseLes occasions d’examens de dépistage de l’adulte jeune (examens prénuptiaux et service militaires) ont diminué. Les femmes sont plus fréquemment atteintes que les hommes (cf plus loin : facteurs de risque). Pour de nombreux auteurs, c’est au cours de la grossesse qu’a été découverte la positivité des anticorps de HVC pour 53,9 % -Minola 1999 (39) et 69% des femmes enceintes positives (22 patientes sur 32 positives/4729 échantillons testés) –Ward 2000- (62). Le moment du dépistage au cours de la grossesse reste à définir car la fenêtre sérologique est au minimum de 3 mois. Le dépistage a pu être pratiqué sur sang du cordon, il est le reflet des anticorps maternels. Le dépistage chez le nouveau-né est d’interprétation difficile car il existe des anticorps transmis passivement. Plusieurs dates ont été proposées chez le nouveau-né, à 3 mois , à 6 mois, à 18 mois et même à 24 mois après la naissance pour confirmer la disparition totale des anticorps transmis passivement. Pertinence et acceptabilité des tests de dépistage de l’hépatite CPour le dépistage, les tests utilisables sont le dosage des anticorps sériques anti-virus de l’hépatite C . Deux méthodes ont été proposées : ELISA(enzymes) la principale méthode ( B70 = 121,80 francs) et RIBA (immunoblot), moins utilisée. Leurs sensibilités respectives ont été de 100% et de 99%. Leurs spécificités respectives ont été de 99,6 et 99,9%. La virémie ARN de l’hépatite C recherchée par PCR est le critère diagnostique : sensibilité de 100% (sauf en phase très précoce). Cette dernière technique a confirmé le diagnostic d’infection avec une spécificité de 97% (IC 95% =96-99), quelque soit le stade de la grossesse -Gibb 2000- (19). Le taux de faux positif a été de 0,2% -Ward 2000 ( 62). L’acceptabilité des tests chez les parturientes a été bonne. Pour 207 femmes à qui le test a été proposé alors qu’elles étaient enceintes, 84% des parturientes acceptaient de faire le test, et 92% pensaient qu’il devait être proposé systématiquement aux femmes enceintes –Ward 2000- ( 62). Aux USA, sur Internet, le test VHC est disponible comme « home test » au prix de 69,95 dollars. Prévalence de l’hépatite C pendant la grossessePar dosage des anticorps anti-HCV, la prévalence chez la femme enceinte a été évaluée. Il existe des variations géographiques : AFRIQUE
ASIE
AUSTRALIE - 1,45% en Australie -Sfameni 2000- (55) AMERIQUE
EUROPE
La prévalence de l’infection par VHC confirmée par virémie maternelle par ARN VHC par PCR a varié selon les pays. AFRIQUE
ASIE - 0,75% pour 16714 femmes enceintes - Moriya 1995 – (40) EUROPE
En Europe, la prévalence a été estimée de 0,1 à 1%. Elle serait souvent sous-estimée - Minola 1999 – (39). La race n’interviendrait pas - Ades 2000- (1), mais la prévalence augmenterait selon l’origine géographique. Elle a été plus marquée en Afrique centrale et en Asie du sud. Variation des génotypes rencontrésLe génotype Ib semble prédominer - Salmeron 1998 – (53). Deux études récentes ont semblé le confirmer : - en Russie : La prévalence du génotype 1b a été de 72,9%, le 3a a été de 15,7% (surtout chez l’enfant de 0 à 14 ans), le 2a et le 2 b ont été 2,9% - Kuzin 1999 – (28). - à Formose La prévalence du génotype a été pour le 1b de 65%, le 2a de 26%, le 2b de 7%% - Lin 1996 – (31 ). Ceci aurait une importance thérapeutique. Certains génotypes répondraient mieux au traitement. Facteurs de risques d’hépatite CClassiquement l’interrogatoire, la clinique (l’asthénie ( 18%), l’ictère (5%) dans le réseau sentinelle en France en 2000) ou la biologie (élévation des transaminases- 31%- dans le réseau sentinelle en France en 2000) et la recherche de facteurs épidémiologiques suffiraient à dépister la quasi totalité des patientes infectées. Parmi les facteurs épidémiologiques prédictifs ont été retenus : la sérologie HIV +, , un partenaire avec un facteur de risque d ‘hépatite, un âge supérieur à 30 ans, , un antécédent de drogue, une transfusion, une maladie sexuellement transmissible, une hépatite, la notion d’une incarcération. La sensibilité atteindrait 99%- Leikin 1994 – (30). La drogue : Elle est actuellement l’un des facteurs de risque très prédominant. La majorité des nouvelles contaminations en France seraient secondaires à la toxicomanie. Les toxicomanes par injection intraveineuse - Marranconi 1994 – ( 33) et par voie nasale - Conférence de consensus 1997 – (11) sont considérés comme patients à risque. L’utilisation ou l’échange de seringues non stériles seraient un des facteurs de risque - Chang 1995 – ( 9). Même le partage du mode de préparation interviendrait ( cuillère, coton, drogue elle-même). Les droguées les plus âgées et les plus anciennes utilisatrices seraient les plus exposées - Latt 2000 – (29). Depuis les années 1980, les précautions prises contre le VIH ont abaissé l’incidence de l’infection à VHC. En Italie, les antécédents de drogue seraient retrouvés plus souvent que les antécédents de transfusion : proportion de 18 drogués pour 1 transfusé. En Allemagne 20% des porteuses d’antiVHC étaient toxicomanes - Hillemans 2000 – (21), soit 2 toxicomanes pour une transfusée. A la Réunion la prévalence pour le VHC serait inverse de 14 transfusées pour 1 toxicomane - Michault 2000 – (38). En Angleterre, 38 à 86% des toxicomanes par injection seraient VHC positifs tandis que les consultants pour affections génito-urinaires et MST n’avaient que 2,6 à 12,3% de VHC. Mais 95% (125/131) des toxicomanes enceintes étaient porteuses d’anticorps anti-VHC à Sydney - La tt 2000 – ( 29). Dans le travail de Ward , le taux de toxicomanies était significativement plus élevé dans le groupe des nouveaux cas. En France dans le réseau sentinelle des généralistes qui a évalué la population générale, 42% étaient des usagers ou d’ anciens toxicomanes. Les antécédents d’hépatite aigue ou chronique cas L’élévation des transaminases inexpliquée doit faire pratiquer la recherche du VHC. Les antécédents d’autres hépatites sont retrouvés - Salmeron 1998 – (53). La prévalence de l’hépatite C chez les femmes ayant une hépatite B est de 2,7% au lieu de 0,6% chez les femmes indemnes d’hépatite C - Alvarez-Munoz 1997 – (3) . En France 33% de la population générale dépistée par le réseau sentinelle avait un antécédent d’hépatite - Massari 2001- ( 34) La contamination par le sang et ses dérivés : Le risque pour le VHC serait inférieur à celui de la transmission de l’hépatite B- Kaufman 1997 – (25).. Les patients suivis en centre de transfusion ( 53,6%), les prisonniers (24,5%, les hémopathies (13,8%), les patients psychiatriques (5,4%), les personnels soignants ( 3 ,9%) ont été des patients à risque de portage d’hépatite C en Russie – Kuzin 1999 – ( 28). La conférence de consensus de 1997 ajoutait le personnel d’urgence (Samu, pompiers en cas d’accident susceptible d’être contaminant). En fait, pour le personnel soignant, le risque serait le même que celui de la population générale – Kaufman 1997 – (25). A Munich, 11%des patients HCV avaient été transfusés - Hillemans 2000 – ( 21). Les antécédents personnels de transfusion avant 1991 sont donc à retenir comme facteur de risque – Salmeron 1998 – (53). En France, dans l’enquête du réseau sentinelle , les antécédents de transfusion représentaient 21% de la population générale – Massari 2001 – (34). Pour les produits d’origine humaine, il n’existerait que peu de cas rapportés de transmission de l’hépatite C par des immunoglobulines. C’était en l’absence d’inactivation des virus et chez un seul producteur d’immunoglobulines IV – Tabor 1999 – (57). De nombreux cas sont survenus en Irlande, en 1977 et 1978 et découverts en 1994 - Jabeen 2000 – (24). Il n’y aurait plus eu de cas rapporté depuis 1994. Le risque de transmission sexuelle du VHC Il est bas. Il a été estimé à 2,7% chez les monogames après 12 ans d’évolution. Les antécédents d’infection VHC du mari seraient plus souvent retrouvés –Salmeron 1998 – (53). Seuls 21,1% des partenaires de femmes enceintes porteuses d’anticorps anti-hépatite C étaient porteurs d’anticorps. Le risque de transmission serait faible – Minola 1999 – (39). La transmission sexuelle serait accrue par la coinfection avec le VIH - Benjelloun 1996 – (6). Le préservatif ne serait recommandé que chez les multipartenaires sexuels et chez les sujets à haut risque de transmission - Zarski 1999 – (66). L’absence de préservatif lors de rapports extra-conjugaux serait une facteur de risque – Salleras 1997 – (52). En France, dans le réseau sentinelle des généralistes en population générale 12% des patients avaient un partenaire sexuel positif pour VHC – Massari 2001 – (34). Il est difficile de distinguer le rôle des contacts sexuels et des contacts directs. Il faut éviter le contact avec les instruments personnels: les rasoirs, les brosses à dents, les instruments à ongle des patients porteurs. La prévention est inutile pour les ustensiles culinaires - Zarski 1999 – (66). La séropositivité VIH Parmi la population testée par le réseau sentinelle des généralistes, 8% des patients de la population générale ont été positifs pour le VHC et le VIH. Le contact avec du matériel contaminé Les antécédents d’intervention, le contact avec les instruments chirurgicaux ou endoscopiques, les injections avec les seringues et les aiguilles ou les plaies accidentelles ont été signalées dans une proportion moindre que pour l’hépatite B. En France , le réseau sentinelle a dépisté dans cette catégorie en population générale 4% des patients. Les pratiques cosmétiques Percing, tatouages ont été signalés comme facteur de risque – Ades 2000 – (1). Par le réseau sentinelle des généralistes, en France en 2000, 8% des patients ont été testés Un voyage récent en région à risque Par le réseau sentinelle des généralistes, en France en 2000, 8% des patients revenant d’Afrique centrale ou d’Asie du Sud ont été testés – Massari 2001 – ( 34). Les conditions socio-économiques : Certaines conditions socio-économiques ont été relevées. Par exemple, le fait d’être célibataire (OR= 2,7), d’être d’origine italienne plutôt qu’immigrée (0R= 3,07), le chômage (OR=6,1) – Baldo 2000 – (5). Le sexe féminin Les femmes ont été plus atteintes que les hommes : 58% des patients dépistées par le réseau sentinelle en population générale –Massari 2001 – ( 34). L’âge La prévalence de l’infection VHC augmenterait avec l’âge - Ades 2000 – ( 1). Elles serait maxima dans le groupe 30-39 ans – Wong 2000 – ( 63), - Kuzin 1999 – (28). En France le réseau sentinelle donne un âge moyen de 49,4 ans - Massari 2001 – (34), ce qui est un âge au-delà de la période concernée par la grossesse. Les patients bénéficiaires de transplantation d’organe, les hémodialysés, les hémophiles, les anciens prématurés.. Ces patients cumulent de multiples facteurs de risque et font partie de la catégorie à risque - Ades 2000 – (1). L’ancien prématuré est exposé à de multiples risques de contamination et il serait à très haut risque. Les fausses-couches avant 20 semaines Elles ont été signalées sans argument démonstratif - Sfameni 2000 – (55). ___________________________________________________________________________ Tableau I : TABLEAU RECAPITULATIF DES FACTEURS DE RISQUE D’INFECTION PAR VHC
___________________________________________________________________________ Infection à VHC et assistance médicale à la procréation (AMP) Les patients sont classiquement récusés en cas de VHC en raison de la présence possible du VHC dans le sperme ou du risque de contamination maternelle de l’enfant. Le père infecté par le VHC comporterait moins de risque de transmission à l’enfant que la mère, car le sperme est rarement contaminé. Des protocoles sont à l’étude dans quelques centres français ( CECOS Paris). Les pères séropositifs VHC devraient être adressés à ces centres spécialisés qui travaillent sur ce sujet. Risques de la méconnaissance de l’hépatite C pour la mère En cas de séropositivité pour le VHC, 5% des patients dépistées n’exprimeront aucune manifestation clinique ou biologique. L’asthénie n’a rien de caractéristique en cours de grossesse. Seules 10% des formes cliniques seraient aigues. La normalité des ALAT ne préjuge ni de l’activité , ni de la gravité de la fibrose extensive que seule la biopsie hépatique peut documenter. Influence de l’hépatite sur la grossesse : L’hépatite n’a pas de conséquence sur la grossesse et son déroulement (taux de fausse couche, taux de césarienne, taux de prématurité, taux de mortalité périnatale). La cholestase gravidique serait plus fréquente et plus précoce en cas d’hépatite C – Locatelli 1999 – ( 32). Elle justifierait la recherche de l’hépatite C dans cette situation. La grossesse n‘est pas contrindiquée par l’hépatite C de la mère - Zanetti 1999 –( 65), ZarskI 1999 – ( 66). De nombreux cas d’ hépatite C sont survenus en Irlande, en 1977 et 1978 et découverts en 1994. Après 20 ans, 100 femmes infectées ont eu une grossesse et parmi elles 85 ont accouché à terme, 11 fausses-couches sont survenues, 4 accouchements prématurés, une gémellaire. Une fausse-couche est survenue après une infection à HCV. Deux morts néo-natales avec malformations graves sont survenues chez ces femmes HCV + - Jabeen 2000 – (24). Ces chiffres (à l’exception des morts nés malformés) ne diffèrent pas des données épidémiologiques habituelles en dehors de toute hépatite C. Influence de la grossesse sur l’hépatite : Classiquement la grossesse n’aggrave pas l’hépatite C - Latt 2000 – (29). La grossesse semblerait même avoir un effet bénéfique sur les transaminases en cours de grossesse.se relèvent après l’accouchement - Conte 2000 – ( 13). On a constaté une élévation de l’alaline-aminotransférase à un taux supérieur à 55 UI/L chez les femmes virémiques après l’accouchement - Latt 2000 – ( 29). La grossesse interviendrait par un mécanisme immunitaire. En fait une démonstration récente a montré que les biopsies hépatiques comparées avant et après grossesse chez des femmes enceintes et non enceintes avaient des scores inflammatoires aggravées chez les femmes enceintes par rapport aux femmes non enceintes. La progression annuelle des taux d’activité et de fibrose a été supérieure en post-partum chez les femmes enceintes - Fontaine 2000 – (18) . L’infection chronique menace la mère victime d’une hépatite C dans une forte proportion de l’ordre de 80%, comme l’ensemble des patients - Chang 1995-(9). Le taux d’hépatite chronique provoquée par l’hépatite C est inférieur à celui de l’hépatite B –Chang 1995 – (9). Entre 20 et 50% des sujets vont guérir spontanément. 50 à 80% des patients vont passer à l a chronicité. Parmi les facteurs prédictifs d’une évolution rapide vers les complications, certains ne concernent pas ou rarement la femme enceinte : l’âge au-delà de 40 ans, le sexe masculin, une durée d’évolution supérieure à 20 ans. Par contre, une co-infection par l’hépatite B ou le VIH (accélère de 2 à 3 fois l’évolution vers la cirrhose), une poursuite de la consommation d’alcool associée peuvent survenir chez la femme enceinte. La cirrhose affectera 10 à 20% des patientes. Un tiers évoluera en 10 ans (surtout les plus alcoolisées). Un tiers aura une progression très lente ou une absence de cirrhose. Un tiers sera d’évolution incertaine. Aux USA 30% des transplantations hépatiques sont effectuées chez des porteurs hépatites C – Wong 2000 – ( 63). Le cancer du foie se développera chez 1 à 5% des porteurs chroniques après une ou plusieurs décennies. Risques de transmission de l’hépatite C au nouveau-né. La prévalence de l’infection par VHC varie chez l’enfant en Europe de 01 à 0,4% - Ruiz-Moreno 2000 – ( 49). Le risque global estimé serait 4 fois plus grand pour le VHC que pour l’HIV : 1150 enfants atteints d’hépatite C versus 330 enfants atteints par HIV en Angleterre pour 730.000 accouchées – Ades 2000 – (1). Pour certains auteurs, le risque de transmission périnatale est très faible de la mère à l’enfant (exemple Menendez 1999 – (36) sur 43 mères infectées ne trouve aucun enfant infecté 2 mois après l’accouchement. A 18 mois un enfant a été infecté). Parker signale des mères séronégatives VHC avec des enfants séropositifs VHC. Il a évoqué une infection nosocomiale ou non transmise in utéro - Parker 1999 – ( 43). Le risque de transmission mère-enfant a été évalué à un taux de 0 à 18% - Hunt 1997 – (22). Le risque serait inférieur à 6% - Conférence consensus 1999 – (12). Le risque de transmission est doublé par le portage de HIV concomittant. Le risque doublerait ( de 6 à 15% -Ades 2000 – ( 1)). Il dépendrait du nombre de copies et un taux supèrieur à 1 million serait dangereux - Hunt 1997 – (22). La transmission mère-enfant du VHC serait plutôt transversale que verticale – Menendez 1999 – (36), - Hunt 1997 – (22). Ces chiffres devraient être revus à la baisse. Voici les derniers chiffres retrouvés : - 2,3% - Jabeen 2000 – (24) - 2,7% des enfants infectés – Polatti 2000 –( 45 )
La valeur prédictive négative des tests de dépistage par PCR chez l’enfant après 3 mois serait de 98% - Thomas 1997 – (59). La cinétique des anticorps doit être suivie entre 12 et 24 mois - Gibb 2000 – (19). 95% des enfants non infectés avaient leurs anticorps disparus 12 mois après l’accouchement chez les mères à virémie nulle - Gibb 2000 – (19). A 24 mois les anticorps persistaient chez les enfants de mère infectée. La décroissance des anticorps est plus rapide en cas d’absence de virémie maternelle. Facteurs d’aggravation de la transmission L’amniocentèse Les avis sont contradictoires. Chez des enfants infectés par le VIH, la fréquence observée de l’amniocentèse a été trouvée à un taux de 22,5% d’amniocentèses . Ce taux observé paraît plus élevé que le taux attendu. Ceci pourrait faire évoquer une contamination au cours de l’amniocentèse - Cohen 1998 – (10). Chez des mères dont 16 étaient virémiques au 4° mois de gestation pour VHC, d’âge moyen 39 ans, une étude prospective de 22 amniocentèses a été effectuée. Un seul liquide a été trouvé positif sans que l’enfant ne soit infecté et les auteurs ont invoqué une possible contamination du prélèvement du fait du passage transplacentaire de l’aiguille - Delamare 1999– (14).. La pratique de l’amniocentèse nécessiterait la connaissance de l’état sérologique de la patiente. Faudrait-il pratiquer un dépistage de l’hépatite C avant toute amniocentèse ? Le mode d’accouchement Cet aspect est très important pour l’accoucheur. Matsubara évoque cette possibilité en montrant que c’est au moment de l’accouchement que le risque serait augmenté - Matsubara 1995 – (35). Classiquement le risque ne dépendrait pas du mode d’accouchement - Zanetti 1999 – (65), Samdal 2000 – (54), Conte 2000 – (13). En fait, d’après un travail récent –Gibb 2000 – (19), le risque dépendrait du mode d’accouchement. Il serait aggravé par l’accouchement par la voie basse par rapport à la césarienne (RR 7,7). La césarienne membranes intactes réduit le risque de transmission de 0, 87 (p=0,04). Ceci a été établi pour 32 enfants nés par césarienne. - Gibb 2000 – (19). Ce nombre de 32 cas est restreint pour étendre d’emblée la césarienne à tourtes les hépatites C, mais la fréquence plus élevée en cas d’accouchement par les voies naturelles et de césarienne après 6 h de rupture des membranes fait réfléchir à une possibilité de transmission différente selon le mode d’accouchement. Le taux sérique maternel d’alanine transférase (ALT) Il indiquerait un risque accru de transmission lorsqu’il est égal ou supérieur à 110 UI/l chez la mère – Xiong 1998 – (64) . Le taux de virémie maternelle Le taux de transmission a varié dans une étude de 0 à 41% - Thomas 1998 – ( 59). Le titre de VHC RNA était plus élevé chez les mères d’enfants infectés - Casanovas Lax 1997- ( 8) que chez les mères d’enfants non infectés - Matsubara 1995 – (35). Un taux de copie infèrieur à 1 million de VHC RNA diminuerait le risque de transmission (taux de 2/30= 6%) – Thomas 1998- (59), - Hunt 1997 – (22), la transmission serait proportionnelle au taux de VHC RNA maternel – Hunt 1997 – ( 22). Pour d’autre le taux de virémie intervient sans qu’un titre seuil puisse être défini. L’infection à VIH concomittante Le taux de transmission a été accru. Le taux de transmission a été doublé ( estimé à 18% chez les mères HCV positive HIV - et entre 6 à 36% en cas d’infection HIV concomittante (Hunt)). Il a été multiplié par 5 ( de 10% chez les HIV- versus 50% si HIV+ (étude compilée de Thomas)). Le risque relatif d’infection à VHC a varié de 3,8 chez les femmes HIV + par rapport aux femmes HIV- Gibb 2000 – ( 19).à 8,2 . La charge virale du VHC augmenterait avec l’immunodéficience. L’immunodéficience serait sans effet pour Conte. Risques de l’hépatite C transmise à l’enfant Le nouveau-né n’est habituellement pas ictérique - Zaneti 1998 - (65). L’infection maternelle à VHC dépistée n’aurait pas de conséquence sur la mortalité périnatale. Il n’y a pas eu de différence entre les morts foetales après 16 semaines d’aménorrhée dans une population de mère infectées et de mères non infectées VHC – Eskild 2000 – ( 17). Pour 20 nouveaux –nés égyptiens nés infectés, 16 ont eu une hépatite chronique, 3 sont décédés d’insuffisance hépatique sévère à 6 mois, 9 sont restés asymptomatiques – Kumar 1997 – ( 27). Le taux d’hépatite chronique transmise a été inférieure pour l’hépatite C au taux transmis d’hépatite B. Il n’y a pas de vaccination possible pour l’enfant exposé. Le taux d’hépatite chronique serait de 60 à 80%. Le pronostic est mauvais chez les multitransfusés, les cancers, les thalassémiques - Ruiz Moreno 1999 – ( 50). Les séquelles à 20 ans seraient de gravité modérée - Ades 2000 – (1). L’enfant serait globalement moins sévèrement atteint que sa mère. Traitement efficace pour la mère et l’enfant Il faut souligner que les critères de guérison sont histologiques hépatiques et virémiques (négativation à 6 mois de la virémie) . Ils ont été copiés sur ceux de l’hépatite B. Il n’est pas certain que ces critères garantissent d’une guérison à long terme sur cette maladie évoluant sur 20-30 ans. Après 3 mois si le traitement n’a pas entraîné d’amélioration, il est abandonné. En dehors de la grossesse, avec l’interféron alpha, le traitement comportait 40% d’efficacité à 3 mois sur les critères hépatiques - Ruiz-Moreno 1999- ( 50). Deux faits thérapeutiques nouveaux sont intervenus. Ces éléments ont été communiqués lors du rapport du NHS de juin 1999 sur l’efficacité de la ribavirine associée à l’interféron dans le traitement de l’hépatite C . Enfin une réunion très récente de septembre 2000 a rapporté l’efficacité de nouveaux médicaments, les peg interférons. L’apparition de la ribavirine. Elle a obtenu une amélioration supplémentaire de 25%. Certains génotypes bénéficieraient de 44% d’amélioration. Le second apport thérapeutique a été obtenu par les peginterférons alpha 2 b (Viraferon-Peg*). Associés à la ribavirine (Rebetol*), ils ont obtenu d’excellents résultats avec un taux moyen de 54% de réponse virologique. La dose de traitement et le génotype interviennent. Chez l’enfant le taux de réponses favorables à l’interféron dans l’hépatite chronique a été de 40% - Ruiz-Moreno 1999 – ( 50). Mais ces nouveaux médicaments ne pourront être utilisés chez la femme enceinte qu’après une longue phase d’essai. Acceptabilité du traitement chez la mère et l’enfant Le traitement par interféron comporte des effets secondaires. La dépression serait dépendante de la durée du traitement et parmi les symptômes le moins toléré. L’anémie est le second symptôme à surveiller. Un syndrome pseudo-grippal est très fréquent. Une alopécie a été signalés. Peu de patientes ont été traitées en cours de grossesse par interféron. Dans une série de 23 femmes enceintes, une seule hépatite C avait été traitée - Trotter 2001 – (60). La ribavirine est tératogène pendant la grossesse . Une contraception efficace de 6 mois est nécessaire après traitement d’une patiente. Pour l’instant, le traitement correct (associant ribavirine et peg interféron) maternel est impossible. Lorsqu’un traitement efficace sera autorisé chez la mère et son enfant, une bonne observance thérapeutique peut être attendue pendant la grossesse du fait de la motivation maternelle. Risques de transmission de l’hépatite C par l’allaitement Le taux de copie de VHC RNA serait bas dans le colostrum. Le risque serait nul – Samdal 2000 – (54), Conte 2000 – ( 13), Tanzi 1997 – ( 58), Polykwa 1997 – ( 46). Pour d’autres auteurs il dépendrait de la virémie maternelle. Aucun effet n’a été observé chez 59 femmes virémiques qui ont allaité dans l’étude Dublin –Londres- Gibb 2000 – (19). Moment idéal du dépistage pergravidique de l’hépatite C Le dépistage doit-il être prénatal, au 1° trimestre, en fin de grossesse, sur le sang du cordon, chez nouveau-né et jusqu’ à 24 mois ? Il est difficile de savoir quel est le meilleur moment ? Une fenêtre sérologique avec absence d’anticorps pendant 3 mois est connue. Les immunodépresseurs diminuent la présence des anticorps. Rentabilité du dépistage de l’hépatite C La recherche de facteurs épidémiologiques à l’interrogatoire diminue les coûts de 55% -Leikin 1994 – (30). Les QALY (quality adjusted life years) sont les critères médico-économiques permettant d’apprécier l’efficacité et la rentabilité d’un dépistage. Ils représentent le produit de l’espérance de vie par la qualité de vie (QWBI ( quality of well being index)). Ils ne sont pas établis chez la femme enceinte pour l’hépatite C. Par analogie avec ceux obtenus dans l’enquête du NHS pour l’hépatite B, il faudrait qu’ils atteignent pour la mère 2,1 années par an et de 9,8 ans dans l’absolu. Bénéfice éventuel d’un dépistage en cours de grossesse pour le personnel soignant, la prévention des infections nosocomiales, la limitation des infections transmises : Théoriquement, l’identification des porteurs du VHC pourrait diminuer la masse globale de VHC et diminuer le risque d’infection transversale ou verticale. Le long portage chronique du VHC expose à de nombreuses occasions de contamination – Alter 1996 – (2) et ne met pas à l’abri l’entourage. Pour le personnel soignant une prévention universelle serait nécessaire et suffisante pour l’hépatite C -Conférence de consensus 1999- ( 12). Il faut protéger le personnel des plaies, de la contamination par le sang et du contact avec les objets souillés pour prévenir les infections professionnels et les infections nosocomiales – Zarski 1999 – ( 66). Il faut expliquer aux patients séropositifs VHC, la nécessité pour eux d’une restriction alcoolique, pendant la phase aigue et pendant le traitement. Il faut leur expliquer la nécessité de prévenir le personnel soignant de leur positivité VHC – Zarski 1999 – ( 66). Il faut enfin rappeler qu’ils ont l’interdiction définitive de donner du sang, leurs organes, leur placenta. CONCLUSIONCertains auteurs sont favorables au dépistage systématique - Minola 1999 – (39). De nombreux auteurs sont défavorables ( en Norvège - Samdal 2000 - (54), en Australie – Sfameni 2000 – (55), en Italie - Zanetti 1999 – (65), Conférence de consensus 1999 – ( 12). L’impossibilité thérapeutique de la mère et du nouveau-né sont les raisons les plus souvent invoquées. D’autres invoquent des raisons de coût. Certains éléments nouveaux méritent à notre avis la poursuite de notre attention. Les insuffisances de l’interrogatoire, la prévalence sous-estimée de l’infection à VHC, de l’importance du réservoir actuel non dépisté, les incertitudes du caractère infectant potentiel de l’amniocentèse ou de la prédominance chez les femmes des infections à VHC ou enfin de l’occasion privilégiée du dépistage que constitue la grossesse sont des éléments à retenir. Mais c’est surtout la prévention de la transmission verticale par la césarienne ou la découverte ultérieure de traitement non toxique autorisé chez la mère et le nouveau-né qui pourraient faire adopter un dépistage obligatoire chez la femme enceinte. Bibliographie
|
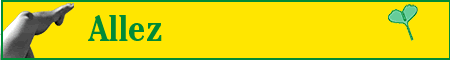
Cliquez ici pour les
mentions légales
|
Naître
égaux - Grandir en santé programme intégré de la promotion de la santé
et de prévention en périnatalité. projet ayant "pour but de démontrer
l'efficacité d'une intervention en milieu d'extrême pauvreté pour réduire
les inégalités sociales de santé et améliorer la santé et la qualité de
vie des nouveaux nés et de leurs parents". |
|
|
|
Cette Newsletter a été envoyée à 2591 abonnés |