d'avril 2001
| Newsletter
d'obstétrique d'avril 2001 |
Voici la newsletter d'obstétrique d'avril 2001
| La Revue de la littérature de Michel Briex est
remplacée ce mois ci par le compte rendu réalisé par Yves Domenichini
de la session sur Le Retard de Croissance Intra Utérin des récentes
Journées de Médecine Foetale de Morzine
Nouveautés sur gyneweb et sur le web
|
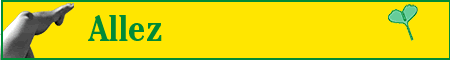
Cliquez ici pour
les mentions légales
|
Le Retard de Croissance Intra Utérin Table ronde très complète qui a fait le tour de la question en abordant aussi bien les problèmes de définition, d’étiologie que ceux de surveillance et de devenir.
Définition
DEFINITION, EPIDEMIOLOGIE Le problème doit être correctement positionné d’emblée car le RCIU est une pathologie importante par rapport aux enfants de poids normal du fait d’une mortalité in utero et néonatale non négligeable mais aussi d’une morbidité à la fois immédiate mais aussi à long terme ( devenir des enfants ) et à très long terme ( devenir des adultes) DEFINITION Actuelle Le terme de dysmaturité ne doit plus être utilisé car beaucoup trop confus. Celui de petit poids de naissance pour l’age gestationnel est une définition beaucoup plus claire. Nouvelle Une notion nouvelle apparaît de plus en plus est celle de « restriction de croissance » qui permet de parler de tous les enfants qui sont petits par rapport à ce qui était programmé en fonction de la taille, du poids des parents. Donc pour certains enfants il ne s’agira que de petit poids de naissance ( PPN ) et pour d’autres ce sera une restriction de croissance. La plupart du temps, le PPN est petit constitutionnellement. Seuls ceux qui ont une restriction de croissance s’exposeront à des risques ultérieurs. Donc de la notion de petit poids pour l’age gestationnel on passe à la notion de restriction de croissance. QUELLE COURBE EMPLOYER Nature de la courbe Trois sont connues : Lubchenko, Leroy Lefort ou celle d’Audipog. Ces courbes doivent correspondre à la population que l’on a en charge et être vérifiée en fonction de sa base géographique. Elles sont forcément faussées car plusieurs années se déroulent entre la conception et l’utilisation, or la morphologie de la population évolue. A Jeanne de Flandre, c’est la courbe de Leroy Lefort qui est utilisée. Quelle limite prendre L’approche ne peut être qu’une probabilité. Plus le poids s’éloigne du dixième percentile plus le risque est important mais tous les enfants entre le 10ème et le 25ème percentile sont aussi des enfants éventuellement à risque. Amélioration possible La notion de courbe est fondamentale. La restriction de naissance ne s’apprécie que sur une courbe de croissance. Il faut aussi que les courbes in utero correspondent aux poids estimés. Il est d’autre part nécessaire de parler avec précision et estimer en percentile les différentes classes : <3, 3-10, ….. mais on doit aussi s’exprimer de façon encore plus précise : 46ème percentile, 7ème percentile… Il faut tenter le plus possible de modéliser des courbes en fonction de la parité, de la taille, du poids, de l’ethnie. Ainsi, la croissance de l’enfant sera évaluée en fonction de son programme théorique personnel. En conclusion, trois notions importantes à retenir :
DETERMINATION DU TERME : QUAND, COMMENT (R. FABRE) La détermination du terme repose sur la biométrie de datation. Elle concerne les deux premiers trimestres. Après la 24ème semaine, il n’y a plus de datation possible et cela constitue même une faute médico-légale. Il est nécessaire d’utiliser un paramètre ayant une faible variabilité à la fois technologique et biologique. La variabilité technologique se définit par la variation d’une mesure d’un opérateur et d’une machine à l’autre. La variabilité biologique repose quant à elle sur les variations intrinsèques du fœtus. Il faut également que le paramètre ait une courbe de croissance très rapide.
L’auteur rapporte une série personnelle prospective de 109 patientes, dont la grossesse a été obtenue par FIV. Ont été étudiés par écho endovaginale : la CRL, le BIP et le périmètre abdominal. CRL. La coupe doit être parfaitement sagittale, en évitant naturellement le piège de la vésicule vitelline et en ne sous estimant pas la difficulté en cas de gémellaire. Au delà de 11 SA, l’embryon s’incurve et la mesure perd de sa précision qui est de l’ordre de 3 à 4 jours entre 7 et 10 SA. Périmètre Abdominal Se mesure en coupe transversale au milieu de l’insertion ombilicale vers 11SA, ce qui entraîne une certaine précision mais que pour une période très réduite. BIP. Toujours en coupe transversale, au même niveau que d’habitude mais n’a que peu d’intérêt. Il ne doit donc pas être retenu.Seule la mesure de la CRL s’avère suffisamment pertinente pour dater de façon précise la gestation de préférence en utilisant la courbe de Robinson. Les données se modifient.. BIP. Toujours en coupe transversale, au niveau de la masse thalamique. Il faut se méfier des formes du crâne suivant la présentation et à la pression de la sonde. PC. Se fait sur la même coupe. Il est indispensable en cas de microcéphalie et dans les formes particulières de crâne telles que les dolichocéphalies. Son intérêt est supérieur au BIP. C’est le paramètre de choix du deuxième trimestre. Fémur. Sa mesure est difficile. La coupe doit être strictement longitudinale sur le fémur proximale. Il existe d’importantes variabilités technologiques. Il peut être intéressant éventuellement de 17 à 22 SA. Il est d’un apport utile dans le diagnostic des RCIU ou d’éventuelles chondrodysplasie Il n’est plus question de vouloir dater la grossesse. Seuls quelques signes peuvent servir d’éléments d’appoint. Ce sont :
COURBES DE CROISSANCE ÉCHOGRAPHIQUES DE RÉFÉRENCE Il existe de nombreuses courbes standards publiées dans la littérature internationale mais qui sont rarement superposables entre elles et ne correspondant pas forcément aux nécessités locales. Se pose donc le problème de quelle courbe choisir car les facteurs de diversité sont multiples.
L’étude proposée a été élaborée par le Collège Français d’Echographie Fœtale. Elle a été prospective, multicentrique. Elle s’est déroulée sur une courte période avec le recueil de données d’une importante cohorte ( 35500 examens sur 10000 patientes ). Un pré test a permis de tester la méthodologie. Seules ont été exclues :
Ont donc été inclues toutes les autres grossesses uniques. La période de recueil a été de 12 mois couvrant toute l’année1997 sur des patientes dont l’âge gestationnel allait de 11 à 41 SA. Résultats. Les courbes retenues ont été le 50ème percentile. Un premier bornage a été établi au 10ème et 90ème percentile, un deuxième au 3ème et 97ème percentile (population à risque), enfin un troisième < au 3ème et > au 97ème percentile ( troubles trophiques patents). Les courbes de moyennes et de centiles ont ainsi été établies puis le lissage des courbes en utilisant la méthode de régression polynomiale a permis d’élaborer la courbe définitive. Méthodologie. L’imprécision de la mesure échographique risquant de fausser les résultats, une extrême rigueur méthodologique a été nécessaire avec une attention particulière pour les plans de coupe et le placement des curseurs. BIP. Le plan doit passer par le septum lucidum, le quatrième ventricule, les masses thalamiques. Les curseurs seront placés au milieu de la table osseuse. L’inclinaison du plan de coupe suffit à fausser les résultats. DAT. Il doit être mesuré en étant axial et horizontal, à la partie moyenne de la veine ombilicale et du sinus porte, en visualisant les surrénales et l’estomac. Les curseurs seront positionnés : externe, externe. Le repérage du plan cutané externe au troisième trimestre peut poser un certain nombre de problèmes. LF. L’incidence doit être orthogonale. On peut supprimer l’effet incidence en abordant le fémur dans sa partie antérieure et de façon la plus orthogonale possible. Les marqueurs seront placés à l’extrémité de la diaphyse, à l »’endroit où elle s’interrompt pour laisser la place au cartilage épiphysaire. Conclusion. Le bon usage des courbes nécessite :
A noter que des exemples de courbes sont téléchargeables sur le site du Collège : http://www.cfef.org
PERTINENCE DU DÉPISTAGE ÉCHOGRAPHIQUE
La performance de l’échographie dans le dépistage du RCIU nécessite de connaître le meilleur paramètre à étudier dans la population tout venant et celle de petits fœtus. Une échographie isolée à 32 SA, pour une spécificité de 95 % n’aura une sensibilité que de 50%, soit le dépistage d’un RCIU sur deux. Population tout venant Le meilleur paramètre de dépistage du RCIU est sans conteste le périmètre abdominal. On peut situer la hiérarchie ainsi : P Abdominal > DAT > Longueur Fémorale > P Crânien > BIP Si l’on tente de comparer l’estimation de poids fœtal à la pertinence du P Abdominal, il n’existe aucune différence. Lorsqu’un PA grandit moins de 10 mm en 2 semaines, la sensibilité est de 85 % et la spécificité de 74 %. Petits fœtus L’estimation du poids fœtal prend ici toute sa place. Reste à définir la formule utilisée. Il en existe des spécifiques pour les hypotrophes. Il semblerait que ce soit celle de Hadlock ( PC, PA, LF ) qui soit la meilleure. La personnalisation des courbes est une nouvelle fois considérée comme fondamentale. Les seuls pièges à éviter sont la variabilité inter opérateur et la différence de 3 % existant entre une mesure de PA suivant une ellipse ou d’après un tracé avec la trackball. Conclusion La mesure du périmètre abdominal dans la population tout venant et l’estimation du poids fœtal dans celle à haut risque sont les mesures les plus pertinentes dans le dépistage par l’échographie du RCIU. DEPISTAGE DES RCIU ET DOPPLERS ( F. GOFFINET) Il est nécessaire d’identifier dans une population un sous groupe à risque élevé. Il existe une différence entre dépistage qui permet d’appliquer un traitement préventif et diagnostic. Un dépistage nécessite un certain nombre de conditions.
Le but est de dépister les fœtus malades. Le raisonnement doit être différent entre la population générale et une population à risque élevée. Doppler ombilical ( DO ) Dans une population à risque élevée, le taux de faux positif est de 20 %. Dans la population tout venant la sensibilité ne sera que de 20 %. Si l’on compare le DO à la biométrie, la sensibilité de l’estimation du poids fœtal est supérieure au DO. Cependant le DO permet de faire la différence entre les fœtus malades et les autres. Il semblerait donc que la mise en route d’une surveillance lourde de fœtus suspects de RCIU ne devrait se faire que chez ceux qui ont un DO anormal. Dans une population générale, il n’y aucune différence entre le groupe DO systématique et les autres alors que cette différence devient significative dans une population à risque. L’utilisation du rapport cérébroplacentaire permet dans une population avec suspicion d’hypotrophie de distinguer ceux à risque de complications. En conclusion, le DO intervient dans un deuxième temps après un premier dépistage. En revanche dans une population à risque élevée d’hypotrophie, le DO a montré son efficacité. Doppler utérin Son intérêt majeur réside dans sa précocité. Là encore, il possède une bonne valeur prédictive dans une population à risque élevée mais modérée en population générale. Il est beaucoup plus intéressant dans le cadre de la pré éclampsie. Mais surtout, il permet de mettre en route une thérapeutique posant ainsi le problème de l’aspirine dont l’efficacité est désormais prouvée mais dont il reste à déterminer les patientes qui doivent en bénéficier. Si l’on en croit les résultats des deux études prospectives, on ne peut recommander la réalisation systématique des dopplers utérins dans la population générale. Cependant cet examen était réalisé à 22 SA soit trop tard pour apprécier l’efficacité de l’aspirine En conclusion, si l’on veut évaluer la pertinence de l’étude du doppler utérin, il convient soit de le réaliser plus tôt pendant la grossesse, soit d’identifier une population à très haut risque. SYNDROMES GENIQUES ET RCIU Il existe quelques facteurs généraux susceptibles d’intervenir dans l’apparition d’un RCIU.
Ces derniers sont naturellement très nombreux et seuls les principaux seront abordés. Syndrome de Silver RusselIl se manifeste par un retard de croissance sévère à la naissance puisque ces enfants mesurent en moyenne 44 cm. Ils présentent une clinodactylie du 5ème doigt. Leur faciès triangulaire avec un micrognathisme est caractéristique. Leur développement psychomoteur est normal avec une asymétrie corporelle. Le mode de transmission est discuté. En fait il s’agit d’une disomie uniparentale maternelle du chromosome 7. Ces disomies sont le plus souvent accidentelles, ce qui permet lorsqu ‘elle mise en évidence de rassurer le couple sur le plan du conseil génétique. Chondrodysplasies
Il existe une disproportion entre le massif facial conservé et la brièveté du cou et des membres. Pour la même entité clinique, il existe plusieurs anomalies géniques. Pour le même phénotype clinique, il existe des phénotypes géniques différents.
On retrouve la brièveté des membres, le thorax étroit mais normal et le faciès caractéristique.
Le thorax est aussi étroit avec une polydactylie.
L’ensellure nasale est caractéristique avec toujours une brièveté des membres. La caractérisation moléculaire en anténatal est possible.
Dues à une anomalie des peroxysomes, ce qui permet une recherche moléculaire.
Avec de nombreuses fractures entraînant des malformations.
De transmission récessive avec une brièveté des membres et les pouces en adductus. Syndrome de Cornelia de Lange.De diagnostic souvent facile en néonatal, il associe un blépharoptisis, une dysmorphie faciale avec une hypertrichose et une évolution vers un retard mental sévère. Il est parfois associé à des anomalies des extrémités permettant un diagnostic échographique éventuel. Syndromes avec retard mental très sévère.
Il se caractérise par des enfants ayant un nez aquilin, une hypoplasie des ailes du nez, une orientation vers le bas des fentes palpébrales, un gros pouce et un gros premier orteil. Cette anomalie est secondaire à une micro délétion du chromosome 16 très difficile à mettre en évidence.
La dysmorphie est assez modérée avec un ptôsis asymétrique, des narines évasées. Il existe de grosses difficultés d’alimentation en néonatale. Les garçons ont une ambiguïté sexuelle et on retrouve une syndactylie membraneuse entre le 2ème et le 3ème orteil. Le retard mental est excessivement sévère. Il se transmet sur le mode récessif autosomique avec un risque de 25% pour une autre grossesse. Il existe cependant un marqueur génique permettant un diagnostic anténatal. Syndromes plus rares
En conclusion, le RCIU peut constituer dans certaines circonstances un signe d’appel pour une anomalie génique dont la mise en évidence est de première importance pour le conseil génétique des futures grossesses.
SYNDROMES GENETIQUES ET RCIU
Ils ne sont pas rares et sont souvent accompagnés d’anomalies morphologiques. Les plus retrouvées sont les trisomies 13, 18 et les triploïdies. Dans le cadre de la trisomie 21, le RCIU intervient plus tardivement au cours du troisième trimestre. Les remaniements de structure chromosomique ont des anomalies morphologiques sans que le RCIU soit toujours présent. Plus particulier est le problème des mosaïques qui consiste à mettre en évidence deux populations cellulaires ou plus chez un même fœtus. Le RCIU sera fonction du taux de mosaïcisme. Tous les chromosomes peuvent être impliqués que ce soit le 13, le 18 ou d’autres paires chromosomiques. RCIU et anomalies chromosomiques limitées au placenta Depuis la pratique des ponctions de villosités choriales, on a décrit 1% de discordances foetoplacentaires, cette différence définissant les anomalies chromosomiques limitées au placenta ( ACLP ). L’analyse directe des villosités permet d’obtenir le caryotype du cytotrophoblaste, la culture, celle du mésenchyme extra embryonnaire. On en distingue trois types suivant l’endroit où l’on retrouve l’anomalie.
Ces anomalies sont la conséquence d’un accident post zygotique soit par accident mitotique soit par accident « réparateur mitotique » Les conséquences peuvent en être un RCIU, bien que les mécanismes d’interférence avec la croissance soient pour le moins hypothétiques. ; mais aussi des morts du fœtus in utero, des pré éclampsies et des grossesses normales. Expérience bordelaise Environ 10700 prélèvements de villosités choriales ont été étudiés. 97 ACLP soit 0,92% ont été diagnostiquées. Ces ACLP ont eu un taux de FCS de 10% contre 1,7% dans le groupe général. Les ACLP augmentent donc considérablement les FCS. Le taux de RCIU, par contre, est celui attendu (5%) . l’auteur explique ce phénomène par la difficulté parfois de mettre en évidence l’anomalie chromosomique du fait du faible volume du prélèvement qui ne reflète pas forcément l’ensemble du placenta. Les disomies uniparentales doivent être recherchées. En conclusion, l’amniocentèse et la ponction de cordon permettent une approche de l’embryon mais n’étudie pas le versant placentaire qui peut avoir sa part de sa responsabilité dans la genèse d’un RCIU. La placentocentèse, si l’on en a une bonne pratique peut s‘avérer utile dans le cadre d’un RCIU inexpliqué.
INFECTION ET RCIU
C’est en 1940 qu’a été mis en évidence pour la première fois une atteinte fœtale après infection virale lors d’une épidémie virale de rubéole. Sur le plan physiopathologique, on peut distinguer deux types d’infection :
Le CMV C’est un de virus les plus couramment en cause. 40% des fœtus infectés présentent un RCIU. Le stade de placentite est obligatoire, le placenta jouant à la fois le rôle de réservoir et de barrière naturelle. Les mécanismes placentaires se manifestent par une atteinte métabolique des cellules placentaires avec entre autre une diminution des surfaces d‘échanges par une diminution du nombre de villosités choriales. La Rubéole L’infection entraîne une atteinte multiviscérale avec d’une part une diminution des divisions cellulaires, une protéine inhibant les mitoses avec possibilités de cassure chromosomiques, l’atteinte étant variable selon les organes. D’autre part on a mis en évidence une atteinte de l’endothélium vasculaire qu’il soit placentaire ou fœtal. Il faut distinguer l’embryopathie avec les problèmes malformatifs importants et la fœtopathie qui correspond à une infection chronique généralisée. Tableau clinique L’évaluation est difficile. Les atteintes sont évolutives avec un taux élevés d’IMG. Il est nécessaire de s’attacher à la dynamique de croissance et à en rechercher une altération. Les retards symétriques ou asymétriques sont possibles. Une des anomalies principales à éliminer sera la microcéphalie. En ce qui concerne la toxoplasmose, en dehors justement de cette microcéphalie, il n’y a pas en règle générale de retentissement sur la croissance. Comme pour la rubéole, l’atteinte virale est multiviscérale comme il est rapporté dans le tableau ci dessous. 
Pour la varicelle, la forme congénitale se voit avant 21 SA. La microcéphalie est possible avec raccourcissement d’un membre et éventuellement RCIU. Une étiologie infectieuse correspond en gros à 5 à 10% des RCIU. Ce pourcentage est vague et difficile à affiner. Le pronostic Il sera essentiellement fonction de la notion de primo infection ou non. D’autre part une exploration complète du fœtus sera nécessaire avec des examens à évaluer : IRM, PCR quantitative. Il est cependant difficile de refuser une IMG dans un contexte de RCIU et d’atteinte virale quand elle est demandée.
MARQUEURS HEREDITAIRES DE THROMBOSE
La thrombophilie héréditaire se définit comme une anomalie génique portant sur un déficit en antithrombine (AT), en protéine C (PC), en protéine S (PS), par une mutation sur le facteur V (FV de Leiden) ou plus récemment sur la prothrombine ( F II de Leiden) Ces anomalies induisent une augmentation du matériel favorisant la coagulation. Sachant que la prévalence de la thrombose pendant la grossesse est de 1/1000, la thrombophilie ne fait qu’augmenter la survenue de complications obstétricales sévères. Un déficit en antithrombine entraînera un risque voisin de 400, les autres déficits de 2 à 8. Il existe une relation entre les anomalies maternelles prédisposant à la thrombose, les lésions thrombotiques placentaires et la constatation d’un RCIU. Pour le Facteur V de Leiden, les résultats sont quelque peu discordants, le risque étant évalué entre 2 et 5 pour certains, pour d’autres non significatifs. La corrélation RCIU/infarctus placentaire présentant un risque relatif de 8. Pour le Facteur II de Leiden, le risque relatif est de3. Si les anomalies portant sur ces deux facteurs n’ont pas d’incidence sur les fausses couches précoces, elles font passer le risque relatif des fausses couches tardives à 3,3, des pré éclampsies et des HRP à 3,8, et celui des RCIU à 3. La thrombophilie héréditaire s’insert dans un environnement multigénique et multifactoriel avec des associations combinées ou avec des anomalies portant sur les antiphospholipides ou l’hyperhomocystéinémie (HHC). Dans ces conditions le risque relatif augmente de 5 à 8. Ces évènements sont toujours précoces et sévères et récurrents. Se pose alors le problème d’un traitement antithrombotique pour les grossesses ultérieures. Deux questions se posent donc à l’évidence : Quand faire un bilan ?En conclusion, il existe une relation pertinente entre le RCIU et la thrombophilie héréditaire avec une prévalence forte de récidive. Le problème d’un traitement antithrombotique se pose donc tout naturellement.
MARQUEURS ACQUIS DE THROMBOSE
Des modifications physiopathologiques comprenant des lésions de l’endothélium associées à une modification de la réactivité vasculaire et une activation de la chaîne de la coagulation sont responsables des accidents vasculaires de la grossesse : RCIU, HRP, Pré éclampsie. La mise en évidence d’une pathologie maternelle augmentant le risque de thrombose, qu’elle soit acquise ou héréditaire, est de plus en plus fréquente.
Il est associé à des manifestations cliniques de type : thrombose artérielle ou veineuse, thrombopénie, FCS à répétition. Le bilan biologique met en évidence la présence d’anticorps anticardiolipines, d’anticoagulant circulant et le faux VDRL positif. Les anticardiolipines se recherchent en ELISA, avec essentiellement mise en évidence des Ig G, les Ig M ayant un intérêt nettement moindre. Lorsque l’on ait en dessous de 15 U g/l, il n’y a pas de risque, au dessus de 40 la situation clinique doit être appréciée. Plus le taux monte, plus le risque augmente. Ces anticorps peuvent apparaître dans d’autres situations cliniques : le LED, certains syndromes infectieux, des maladies malignes ou même chez des sujets parfaitement sains. Si l’on sait que les APL entraînent un RCIU. Pour la pré éclampsie, les études sont beaucoup plus discordantes. Quel traitement proposer ? Les corticoïdes ont été les premiers utilisés. En fait leur indication principale, est le LAD et les éventuelles FCS à répétition avec présence d’anticorps antiphospholipides. De toutes les thérapeutiques proposées, en cas d’antécédents de FCS, MFIU ou de pré éclampsie et d’augmentation des APL, la meilleure associe : Héparine de bas poids moléculaire et aspirine, dans la mesure où le traitement est débuté de façon précoce.
L’homocystinurie est tellement sévère que l’on en méconnaît les conséquences à l’age adulte et donc les conséquences possibles pour la grossesse. Dans sa forme acquise, elle représente un déficit métabolique en acide folique et en vitamine B6, B12. Elle peut se manifester par une anémie macro globulaire mais aussi par des thromboses Il existerait une association possible entre l’HHC et la pré éclampsie. Lorsqu’une HHC a été mise en évidence à l’issue d’une grossesse avec complications vasculaires, une vitaminothérapie a pu normaliser le taux d’homocystéine. Par contre il n’existe aucune preuve formelle de lien entre HHC et RCIU et donc de l’efficacité d’un tel traitement en cas d’antécédents de RCIU. En conclusion : Pour les APL, il existe une corrélation avec le RCIU mais non établie avec la pré éclampsie. Le traitement est l’association aspirine et héparine de bas poids moléculaire. Pour l’HHC, on retrouve une association avec la pré éclampsie, par contre le traitement par vitaminothérapie n’a pas fait la preuve de son efficacité.
QUEL BILAN ÉTIOLOGIQUE ?
Le Retard de Croissance Intra Utérin est défini par l’auteur suivant celle de LIN ( Obstet Gynecol 1998 ) comme étant la sous expression du potentiel de croissance pour un individu donné, à un age gestationnel donné, secondairement à une ou plusieurs causes. Cela nécessite des normes pour l’âge gestationnel et de définir une population de référence. On peut distinguer quatre groupes étiologiques. GénétiquesOn élimine les faux RCIU constitutionnels constitués par les enfants déterminés génétiquement pour être petits. Dans ce cadre, on distingue :
Elles sont nombreuses : trisomies, anomalies des chromosomes sexuels, délétion, triploïdie, mosaïque confinée au placenta, disomie uni parentale. Il faudra être donc large de prélèvements.
Elles se situent dans un contexte précis avec une multiplicité des syndromes avec le plus souvent un syndrome polymalformatif. Facteurs environnementauxCe sont la malnutrition, le tabagisme, l’alcoolisme maternel et les autres toxiques avec en premier lieu la toxicomanie. Pathologie maternelle préexistant à la grossesseL’HTA chronique, la néphropathie chronique, les thrombophilies, le diabète sont le plus souvent retrouvés.
Le déficit de vascularisation placentaire , l’artère ombilicale unique, l’insertion vélamenteuse du cordon, le placenta praevia, le chorioangiome. Autant de pathologie pouvant être retrouvée dans le cadre d’un RCIU.
Correspond à 5 à 10% des RCIU. En premier lieu, le CMV sans oublier la rubéole.
Se pose alors le problème d’une éventuelle intervention chirurgicale dans un contexte de pathologie chronique. Enquête étiologique Elle reposera sur les antécédents génétiques connus, l’existence d’une pathologie maternelle ou obstétricale. S’il existe une cause évidente, le problème étiologique sera rapidement réglé. Il pourra s’agir d’une pathologie utéroplacentaire « primitive ». Auquel cas seront entrepris un bilan immunitaire, à la recherche d’un terrain thrombotique sans oublier l’histologie placentaire. S’il n’existe pas de cause évidente seront discutés le caryotype fœtal, le caryotype placentaire et la recherche d’une fœtopathie par l’examen foetophathologique du fœtus. Pour l’auteur, au moindre doute une amniocentèse doit être pratiquée pour caryotype et recherche infectieuse essentiellement pour trois arguments : la fréquence des anomalies, la technicité des résultats, le problème de l’information. Il faut noter que ce point à fait l’objet d’âpres discussion entre les partisans de l’amniocentèse « facile » et les autres. Beaucoup d’intervenants présents refusant de pratiquer une amniocentèse lorsque la cause du RCIU est évidente du type d’un RCIU tardif avec cause vasculaire.
SURVEILLANCE ET PRISE EN CHARGE
MANNING La surveillance passe par la recherche de marqueurs biologiques d’asphyxie fœtale aiguë et chronique. Le liquide amniotique est un des éléments majeurs des scores biophysiques. La dynamique de la croissance doit être également un élément important à prendre en compte. Le score de Manning est utilisé dans la majeure partie des centres qui prennent en charge les grossesses à haut risque dans le cadre d’une hospitalisation et peut déboucher sur des décisions d’extraction. En cas d’hypoxie, le fœtus va réagir par des dysfonctionnement cellulaires du système nerveux central qui entraînera une hypoxie avec diminution des mouvements respiratoires, des mouvements fœtaux et un RCF non réactif. Il s’installera aussi une redistribution du flux sanguin. Les effets de l’hypoxie dépendront du caractère aiguë ou chronique. Si la défaillance est aiguë nous aurons une hypotonie, un RCF aréactif. Si la défaillance est chronique, ce sera une diminution du flux sanguin avec comme conséquence un oligoamnios et un RCIU. C’est par la combinaison de ces éléments que Manning a réalisé son score. Il doit être réalisé chez des patientes à haut risque, après 26 SA, avec un examen échographique
Se fait à l’endroit de la citerne la plus profonde.
Réalisée en coupe longitudinale, elle doit durer au moins 20 minutes en recherchant les mouvements respiratoires, ceux du corps et des membres et le tonus en extension du corps fœtal et de fermeture extension des doigts.
Si ces variables sont présentes, on cote la note de 2. Si elles sont absentes, on cotera 0. Un score sera dit normal s’il est supérieur ou égal à 8. Un score entre 4 et 6 avec une anomalie du RCF fera pratiquer 20 minutes d’enregistrement supplémentaires. S’il existe moins de 2 accélérations par 15 minutes, le fœtus sera considéré comme étant en danger. Le Manning, s’il diminue la mortalité périnatale ne détecte cependant pas 1/3 des fœtus qui vont mourir. C’est pourquoi VINTZILEOS a rajouté un grade placentaire et affiné les scores en 0,1 et 2. Pour ce même auteur, il existe une différence de sensibilité des centres vis à vis de l’hypoxie. Les premiers touchés sont le RCF et les mouvements respiratoires. Ensuite viennent les mouvements des membres. D’où un nouveau concept où tous les marqueurs n’auraient pas le même poids dans la prédiction de l’hypoxie fœtale. Si une diminution du liquide amniotique est associée à un RCIU le risque de souffrance fœtale est majeure. Différents auteurs ont tenté d’associer les paramètres biophysiques
En définitive, à la question y a t il un protocole de conduite à tenir, il ne semble pas exister de schéma préférentiel. Le Manning peut être un bon élément prédictif d’une SFA, ce qui est logique puisqu’il associe des signes de SFA et des signes de SFC.
RCF ET RCIU : SPECIFICITES ( B. LANGER ) Depuis les travaux de VISSER par l’étude de l’acidose par choriocentèse, on sait qu’une accélération n’entraîne jamais d’acidose. En cas de tachycardie, de baisse de la variabilité ou de décélérations, l’acidose augmente. L’analyse du RCF est fonction de l’age gestationnel. Il faut également tenir compte d’une pathologie ou d’un traitement associé, de la variabilité de l’interprétation en fonction des individus et de ce que l’on cherche à éviter. Ce n’est que 50% des tracés qui sont réactifs à 26 SA, le pourcentage restant le même à 30SA. Ce n’est qu’à 32 SA que l‘on pourra correctement interpréter la réactivité. L’interprétation des tracés est difficile. La variabilité à long terme n’apparaît que tardivement. Il est donc fondamental de trouver un paramètre chiffré indépendant de toute erreur humaine, permettant d’apprécier l’évolution et d’accéder à des données que l’on ne peut utiliser spontanément. Ce paramètre est la variabilité à court terme ( VCT ) qui est le meilleur aussi bien en spécificité qu’en sensibilité. Il est mis en évidence par l’appareil commercialisé par SONICAÏD. Le seuil d’alerte pour la plupart des auteurs est 3, pour d’autres 3,5. La VCT est avec le doppler veineux le dernier paramètre à s’altérer avant les signes cérébraux.
PLACE DES DOPPLERS ARTERIELS ( M. UZAN ) L’étude des dopplers en cas de RCIU est maintenant bien codifiée. Ils permettent d’apprécier l’hémodynamique materno-fœtale par une technique non invasive et reproductible. Ils sont recherchés sur trois sites : artères utérines, artère ombilicale et vaisseaux cérébraux. Chacun fournit des informations différentes à des moments différents de la grossesse. En présence d’un RCIU, ils devront faciliter le diagnostic, faire le pronostic et aider à la décision d’extraction. Artère utérineLe doppler des artères utérines explore le bassin des résistances au niveau des artères spiralées lors de la colonisation de ces vaisseaux par les cellules trophoblastiques. Si cette colonisation se fait mal, l’incisure protodiastolique va persister. A 22 SA, le doppler des artères utérines peut être prédictif d’éventuelles complications vasculaires de fin de grossesse avec une sensibilité de 30 à 60% et valeur prédictive positive de 10 à 30%. Cependant ce diagnostic est trop tardif. Harrington et Campbel ont montré l’intérêt de la présence d’un notch bilatéral entre 12 et 16 SA par voie vaginale. Dans ce type de circonstances, la pré éclampsie est augmentée avec un risque relatif de 22 et le RCIU de 8,6. Le doppler utérin est donc prédictif mais est difficile à mettre en évidence. Il permet aussi d’orienter le diagnostic, la notion de doppler pathologique à 12 SA faisant penser à une cause maternelle; alors qu’un doppler normal fera plutôt rechercher une cause fœtale ou foetoplacentaire. On peut classer ces dopplers utérins en 3 classes .
On peut trouver également une protodiastole diminuée mais avec un rapport A/C inférieur à 3. L’examen est réalisé par voie abdominale et l’on recherche son évaluation dans le temps (12SA, 22 SA ) la profondeur et la bilatéralité des anomalies. C’est ainsi qu’à 22 SA, on peut retrouver un groupe hétérogène regroupant des patientes avec un doppler normal à 22 Sa mais qui en avait un à 12 SA. Le groupe à très haut risque correspond logiquement à celui avec une incisure à 12 et 22 SA. Enfin la profondeur de l’incisure est importante à prendre en compte. Ainsi un doppler de classe 1 sera sans gravité quant à l’issue de la grossesse. Pour conclure sur le doppler utérin :
En pratique le doppler utérin a pour gros intérêt d’orienter vers une cause fœtale de RCIU. Doppler ombilicalIl évalue la résistance placentaire et le potentiel de croissance fœtal. Il devient pathologique 3 semaines avant la cassure de la courbe de croissance. Il peut être réalisé à partir de la 26ème semaine et possède une excellent valeur prédictive positive. Dans une population à bas risque, il n’y a aucun intérêt à rechercher un doppler ombilical. Au sein d’une population à haut risque, le doppler ombilical diminue la mortalité périnatale, les décès périnataux et les décès in utero. On recherchera une diminution du flux diastolique correspondant à une diminution de la surface d’échange. A un index diastolique nul ou à la présence d’un reverse flow correspond la très grosse majorité des RCIU, MFIU et décès périnataux. Dans le cadre d’index diastolique nul, on ne retrouve pratiquement jamais d’anomalies chromosomiques. Doppler cérébralIl permet d’évaluer les phénomènes de redistribution en cas d’hypoxie. On recherchera la vasodilatation et l’inversion du flux. Dès que l’index est pathologique, on devra toujours le confirmer par un deuxième examen. Enfin, l’anomalie doit être retrouvée sur deux vaisseaux : la carotide et la cérébrale postérieure. ConclusionLe doppler ombilical discrimine avec une bonne sensibilité le fœtus avec un RCIU. Le doppler cérébral ne dépiste pas le RCIU mais le phénomène de redistribution avec inversion du flux signant l’hypoxie. Dans une décision d’extraction, le doppler ombilical et le doppler cérébral seront associés à l’état maternel. Il conviendra d’évaluer la gravité du RCIU par une estimation pondérale en intégrant éventuellement la notion d’arrêt de croissance. On fera un score de Manning et l’on dépistera les toutes premières anomalies du RCF. Ces dopplers sont utilisés à tous les stades du dépistage, du pronostic et de la décision d’extraction. Ils s’intègrent dans une stratégie globale et doivent être réévalués régulièrement.
DOPPLER VEINEUX ( Y. VILLE ) Il reflète la pression de l’oreillette droite et se recherche au niveau du canal d’Arantius. On établira un index de pulsatilité : S.D/Vitesse moyenne. Cet index baisse de façon constante pendant la grossesse à l’inverse de la vélocité qui augmente. L’augmentation de la post charge du ventricule droit va augmenter le reverse flow. Un autre facteur d’augmentation de la post charge est la polyglobulie qui est un des moyens de défense du fœtus. De part la vasodilatation des vaisseaux cérébraux, il y a une diminution de la post charge du ventricule gauche : c’est encore une réaction d’adaptation du fœtus. La disparition de l’onde ou l’apparition d’un reverse flow signe la décompensation. Pour Y. VILLE, la hiérarchie des examens s’établit comme suit :
En conclusion, le doppler veineux dans le canal d’Arantius et la variabilité à court terme sont deux éléments importants pour juger de la répartition et de la modification de la distribution sanguine avant une décompensation fœtale irréversible.
Durant la discussion, un certain nombre de conduites à tenir on pu être élaborées. La surveillance se fait sur la notion d’un age gestationnel clairement établi, de l’estimation ma plus précise possible du poids fœtal et de la réalisation d‘un doppler ombilical une fois par semaine. S’il existe un reverse flow ou index diastolique nul, on réalisera une cure de corticothérapie non répétée. On fera un enregistrement du RCF par méthode informatisée et un doppler veineux deux fois par semaine. Si le doppler veineux est anormal et le RCF anormal : extraction fœtale. Si le doppler veineux est anormal et le RCF normal : après 32 SA : extraction fœtale. Avant 32 SA, il faut que les deux éléments soient anormaux.
DOPPLER CARDIAQUE ( JC FOURON ) L’impact sur la fonction cardiaque d’une insuffisance placentaire se fait à deux niveaux : hémodynamique : modification du remplissage ( pré charge ) et d’éjection ( post charge ) ventriculaires. métabolique : altération des échanges gazeux transplacentaires. Ces deux impacts sont évolutifs et concommittents. Modifications hémodynamiques.
Ce qui dicte la post charge ventriculaire droite est la résistance placentaire qui va diminuer. Pour le ventricule gauche, c’est l’inverse, la post charge va diminuer du fait de la vasodilatation cérébrale de compensation.
L’augmentation de la résistance placentaire va diminuer le débit ombilical. Quelque soit le pourcentage de résistance placentaire, cela va se répercuter par une diminution du débit ombilical. Cette dernière va entraîner une baisse de la pré charge. Chaque fois que l’on diminue le débit ombilical, on crée une situation d’hypoxémie. Modifications métaboliquesFace à cette agression, il existe des phénomènes de compensation cardiaque. Le cœur est capable de résister longtemps. Il va d’abord créer une vasodilatation coronarienne puis augmenter l’extraction de l’oxygène, passer en métabolisme anaérobie pour ensuite créer une angiogenèse. On utilise la fonction systolique . Si la pré charge diminue par diminution du débit ombilical, le débit cardiaque combiné va baisser. Quand on augmente la résistance placentaire, le pourcentage du débit combiné provient d’avantage du ventricule gauche. L’étude de la fonction systolique dit que la pompe ne fonctionne pas tout à fait comme il faut mais qu’elle fonctionne quand même. Le doppler coronarien permet une autre approche. Les coronaires ne sont visibles que lorsqu’elles sont dilatées, donc jamais chez le fœtus normal avant 32 SA. En cas de RCIU, on peut les voir à 26 SA. Dans ce cas, cela signifie que le myocarde est très abîmé. Le doppler veineux ne peut être anormal que quand la pompe reçoit de façon anormale le sang. La fonction diastolique dicte le profil de la vélocité veineuse. Le cœur dans un premier temps va participer aux mécanismes de défense liés aux perturbations circulatoires. Avec l’hypoxie va survenir des phénomènes de décompensation. L’hypoxie cellulaire et l’acidose vont entraîner une dysfonctionnement cardiaque qui se manifestera sur la diastole. La capacité d‘adaptation du myocarde rend peu fiable l’étude isolée du doppler cardiaque dans le cadre du dépistage d’une hypoxémie fœtale au stade de décompensation imminente et de lésions cérébrales irréversibles.
PRISE EN CHARGE NEO NATALE ( J. LERAILLEZ ) Il existe deux urgences : celle de la prise en charge d’un nouveau né en état de mort apparente et celle d’un risque d’inhalation méconial. Les problèmes pulmonaires entraînés par une naissance prématurée peuvent être compensés en parti par la souffrance fœtale chronique qui accélère la maturation pulmonaire mais l’anoxie, l’acidose, l’inhalation la défavorisent. La maturation par corticoïde est donc nécessaire. Le RCIU pose en lui même d’autres problèmes.
Il faut prévoir la déperdition thermique, l’hypoglycémie. L’objectif est une glycémie supérieure à 3 mmol/l ce qui nécessite un apport précoce de 5 ml/Kg., et des apports répétés et continus. Après la salle de naissance, l’hypoglycémie doit être prévenu par une alimentation précoce de l’ordre de 60 ml/Kg ou par une supplémentation. En cas d’échec il faudra mettre en place une perfusion glucidique de 0,35 à 0,5 g/Kg/l. Le glucagon n’a aucun intérêt. La prématuritéElle nécessite une prise en charge spécifique des difficultés respiratoires ( surfactant ) des problèmes nutritionnels car le risque digestif est important ( entérocolite nécrosante ). L’alimentation sera prudente d’où la nécessité de placer ces enfants sous perfusion. Enfin la prise en charge hémodynamique ( canal artériel ) et métabolique (risque d’insuffisance rénale, trouble de la tolérance glucidique ) sera particulièrement attentive. Tous les enfants de moins de 1500 g sont en alimentation mixte. Ceux de moins de 1000 g en alimentation parentérale après la mise en place d’un cathéter épicutanéocave. Ce sont :
Le pronostic est lié au périmètre crânien. C’est son développement ultérieur qui aidera le pronostic. En principe, à l’age de 6 mois, le PC doit avoir rattrapé la norme. Si le PC reste inférieur à la norme, on retrouvera des problèmes scolaires ou d’adaptation sociale. Un deuxième paramètre est important à prendre en compte est le contexte psychosocial. Evolution ultérieure
L’infirmité motrice cérébrale est essentiellement liée à la prématurité. Les anomalies du développement psycho intellectuel sont eux liés aux grands RCIU avec PC < 2 DS non rattrapé à 6 mois, surtout lorsque se rajoutent des facteurs psycho sociaux.
Dans 80 à 90% des cas, les enfants rattrapent une taille normale dans les 6 mois qui suivent la naissance. Après deux ans, il n’y a plus de rattrapage d’où la possibilité d’utiliser l’hormone de croissance dans certaines conditions : RCIU à la naissance, taille < - 3DS à l’age de 3 mois.
Chez l’adulte, les risques d’affections cardiovasculaires ischémiques, d’HTA, d’hyperlipidémie et de diabète insulinodépendant sont très nettement augmentés. ConclusionLa majorité des RCIU ne pose pas de problème dans la plupart des cas. C’est en fait la prématurité qui en pose. L’importance du rattrapage à 6 mois tant pour la taille que pour le PC est fondamentale.
MALFORMATION ET NAISSANCE PRÉMATURÉE Existe t il une malformation qui puisse s’aggraver ou induire des complications physiologiques et pour laquelle il existe une solution chirurgicale possible. En premier lieu, il convient d’éliminer les contrindications à un accouchement prématuré. Ce sont les lésions fixées d’emblée qui ne s’améliorent pas une fois l’enfant sorti. Ce sont :
En second lieu, il faudra mettre en balance, le bénéfice d’une chirurgie sur la malformation et des risques de la prématurité. Le terme est fondamental : au delà de 34 SA, il n’y a aucun problème. En dessous de 28 SA, les séquelles majeures de la prématurité seront à prendre en compte bien avant la malformation. Quelles sont les malformations susceptibles de bénéficier d’une extraction prématurée ? L’hydrocéphalieLa décompression du parenchyme cérébral rapide pourrait être bénéfique. En fait, on sait par des tentatives de chirurgie avec dérivation in utero que le pronostic n’est pas amélioré. Il n’y a donc pas d’indication d’extraction prématurée. Les uropathies malformativesOn est en droit de penser que l’obstruction urinaire entraîne une hyperpression sur le haut appareil détruisant le parenchyme rénal. Des travaux de chirurgie in utero ont montré après dérivation de valves urétrales que si l’oligoamnios était corrigé, l’insuffisance rénale était définitive. Les seules indications d’intervention sont un liquide amniotique normal ou un oligoamnios très tardif.
Le tératome sacrococcygien
Pas d’indication d’extraction prématuré sauf si le tératome est à croissance rapide et le fœtus à un terme raisonnable au delà de 32, 33 SA. En conclusion, il n’y a finalement que très peu d’indication. La seule à retenir est le laparoschisis. Pour les autres cas de figure, il ne s’agit que du ponctuel et du cas par cas.
DEVENIR A LONG TERME ( P.Y. ANCEL ) Il convient de distinguer les RCIU avant terme et les RCIU à terme.
Les tests cognitifs sont bons. Il semble que le pronostic du RCIU dans sa forme sévère soit lié aux séquelles motrices importantes que l’on ne retrouve pas après 34 SA. Le risque est donc lié à celui de la grande prématurité.
Les données sont peu abondantes dans la littérature. Ces RCIU semblent associés à des résultats cognitifs moins bons. On peut considérer que le RCIU constitue un facteur de risque de développement moteur et cognitif. Pathologie à l’age adulte
Le risque relatif d’un accident par cardiopathie ischémique ou accident vasculaire cérébral diminue avec le poids de naissance. Plus le poids est élevé, plus le risque diminue. La TA baisse également en fonction du même critère.
On retrouve les mêmes constatations. Ces pathologies de l’adulte pourraient être en grande partie liées à la malnutrition fœtale. Le processus d’adaptation fœtale à cette malnutrition pourrait être à l’origine de changements importants dans la structure et la fonction des organes. En conclusion, l’interprétation des résultats doit se faire en fonction d’une connaissance précise de l’age gestationnel et de l’environnement familial. De même, si les relations avec une pathologie chronique de l’adulte est désormais établie, l’interprétation et les hypothèses émises doivent être l’objet d’études ultérieures.
|
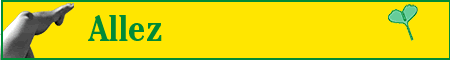
Cliquez ici pour les
mentions légales
Nouveautés sur le web
|
Toxicomanie,
femmes enceintes et maternité : une nécessaire évolution de la prise en
charge .
Prise
en charge de l'interruption volontaire de grossesse jusqu'à 14 semaines
recommandations pour la pratique clinique
présentation (historique, objectifs, organisation), rubrique d'actualités, informations sur les Journées Nationales, études de cas, formation, sélection de liens ;
Dilemmes éthiques
de la période périnatale recommandations pour les décisions de fin de vie
pour l'abstention, la limitation, l'arrêt des traitements et l'arrêt de vie.
|
|
Réduire la mortalité maternelle dans les pays en voie de développement
Des
repas fréquents pendant la grossesse peuvent induire un accouchement
prématuré Une prise de poids excessive pendant la grossesse augmente le risque de difficultés d'allaitement
|
|
Vos remarques et critiques sont les bienvenues : adressez vous à mbriex@club-internet.fr ou webmestre@gyneweb.fr N'hésitez pas à faire part de vos découvertes sur le web en nous envoyant les adresses de sites publiant des articles d'obstétrique. Vous pouvez aussi nous communiquer pour diffusion des compte rendus ou des textes de congrès ou de sessions de FMC à thème obstétrical. Les archives de la newsletter d'obstétrique sont consultables par les non abonnés, elles sont mises à jour avec un mois de décalage par rapport à l'envoi aux abonnés. |
|
Des discussions et débats concernant l'obstétrique ont lieu sur la liste de diffusion gynelist. Gyneweb publie aussi quatre autres newsletters mensuelles et gratuites de gynécologie médicale, de chirurgie gynécologique, d'échographie et de Sénologie respectivement animées par Maï-Eder Blondy, Bernard Cristalli, Jean-Michel Brideron et Fabienne Liebens. Si vous souhaitez ne plus recevoir cette newsletter mensuelle, cliquez ici Cette Newsletter a été envoyée à 2713 abonnés |