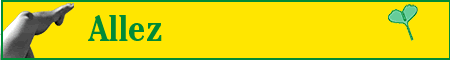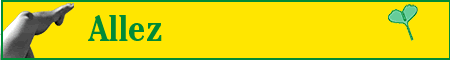|
Mise au point sur les Tocolytiques:
La menace d’accouchement prématuré reste un problème de santé publique important avec un taux de prématurité global de l’ordre de 6,8% environ, le nombre de grand prématurés (inférieur à 32SA) est moins important mais reste encore de 1,6%. A ce jour aucune thérapeutique n’a fait la preuve de son efficacité pour allonger de manière significative (c’est à dire qui puisse réduire la mortalité et la morbidité des enfants) la durée de la grossesse.
En matière de prise en charge de la prématurité la plus grande avancée de ces dernières années semble être l’utilisation large des corticoïdes en cas de menace sévère. Cette maturation pulmonaire s’effectuant habituellement sur deux jours, il semble logique avant tout de pouvoir espérer un traitement tocolytique dont l’efficacité soit au moins suffisante pour mettre en œuvre ce traitement et pour organiser le cas échéant le transfert vers une maternité de niveau II ou III selon le contexte de prise en charge. Les articles qui suivent sont une revue des traitements les plus utilisés à l’heure actuelle.
Tocolyse, utilisation des béta mimétiques dans la menace d’accouchement prematuré : revue critique de la littérature.
Tocolysis, use of beta-sympaticomimetics for threatening preterme
delivery: a critical review. Rozenberg P J Gynecol Obstet Biol Reprod 2001 May ;30(3) :221-230.
L’accouchement prématuré est la principale cause de mortalité et de morbidité périnatale. Depuis ces 40 dernières années, de nombreux traitements ont été testés et utilisés pour essayer d’inhiber le travail prématuré. Cette revue de la littérature se limite aux bétamimétiques. Parmi 36 articles ayant étudié le traitement à la phase aiguë du travail prématuré traité par bétamimétiques IV, 26 sont des études cliniques avec des biais ne permettant pas de les prendre en compte dans ce travail. Sur les 10 études pouvaient être considérées comme des études contre placebo acceptables ; on retrouvait la plus importante (canadian preterm labour study avec 708 patientes) : sept montraient que les bétamimétiques n’avaient pas une efficacité supérieure à elle d’un placebo pour prolonger la durée de la grossesse ou réduire la morbidité néonatale. Seulement trois études trouvaient une efficacité supérieure à celle d’un placebo.
Les bétamimétiques posent un certain nombre d’effets secondaires potentiellement graves : le système cardiovasculaire est le plus atteint mais les effets secondaires concernent aussi le pancréas, les reins, le foie ou l’intestin. Les bétamimétiques traversent rapidement le placenta et il est probable que les effets sur le fœtus soient comparables à ceux observés chez la mère du fait de la stimulation de leurs récepteurs béta. Les études n’ont pourtant montré aucune différence dans la mortalité ou la morbidité des enfants nés de mères traitées par béta mimétiques ou par placebo. L’efficacité des bétamimétiques sous cutanés ou per os a aussi été prise en compte : une méta analyse et deux grands essais randomisés contre placebo ont montré que le maintien du traitement per os n’offre pas d’avantage par rapport à un placebo que ce soit pour la latence entre les MAP, le taux de récurrence de ces MAP ou le taux d’accouchements prématurés. Une seule étude (petit effectif) a montré que le maintien de la ritodrine per os pouvait entraîner un bénéfice. Dix articles ont étudié l’administration continue de la ritodrine à la pompe en sous cutané ; deux seulement étaient randomisées : elles n’ont trouvé aucune différence significative par rapport à un placebo.
Note de l'auteur: Ce travail permet effectivement de remettre les choses à leur place : pour ceux qui en douteraient encore les bétamimétiques n’offrent pas une grande efficacité et n’on pas un effet permettant de prolonger la grossesse. Tout au plus trouve t-on dans certains travaux un bénéfice de quelques heures qui peut être utile pour l’organisation d’un transfert en niveau II ou III ou pour débuter une corticothérapie.
Par contre, il n’existe aucun bénéfice à poursuivre le traitement per os ou en suppos une fois l’épisode aigu passé. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue les dangers potentiels d’une tocolyse avec des accidents cardiovasculaires parfois sévères et un certain nombre de complications importantes à l’actif de ce traitement mal contrôlé.
Tocolyse avec les inhibiteurs calciques.
Tocolysis with calcium-channel-blockers . Tsatsaris V, Carbonne B.J Gynecol Obstet Biol Reprod 2001 May ;30(3) :246-251.
Objectif : Evaluer l’utilisation des inhibiteurs calciques dans la tocolyse.
Méthodes : Revue de la littérature à partir de la base de données medline depuis 1967 sur la toxicité fœtale et l’efficacité comparée aux béta-bloquants.
Résultats : Les données sut la toxicité fœtale chez l’animal étaient rares. Un effet tératogène a été observé pour une grossesse débutante à des doses supérieures aux doses thérapeutiques. A la dose habituelle, aucune anomalie fœtale n’a été observée. L’efficacité pour la tocolyse semble supérieure à celle des béta-mimétiques et la toxicité semble moindre. Les inhibiteurs calciques étaient de surcroît mieux tolérés que les béta-mimétiques.
Conclusion : Les données de la littérature laissent penser que les inhibiteurs calciques peuvent être utilisés comme tocolytiques : leur utilisation est simple et moins dangereuse que les béta-mimétiques mais ils ne doivent pas être proposés dans les situations à faible risque d’accouchement prématuré.
Note de l'auteur: Les inhibiteurs calciques semblent avoir une efficacité relative (comparable à celle de bétamimétiques c’est à dire faible) mais s’ils ne donnent pas de complications cardiovasculaires ou d’anomalies fœtales, leur effet vasomoteur pose souvent des problèmes tels qu’ils ne peuvent être poursuivis à dose efficace. Ils gardent malgré tout l’avantage d’un prix peu élevé et d’effets secondaires moins sévères que ceux des bétamimétiques
Effet cardiovasculaire maternelet fœtal d’un dérivé nitré percutané et de la ritodrine iv.
Maternal and fetal cardiovascular effects of transdermal glycéryl trinitrate and intravenous
ritodrine. Black RS, Lees C, Thompson C, Pickles A, Campbell S. Obstet Gynecol 1999
Oct;94(4):572-576.
Objectif : Étudier les effets cardiovasculaires maternels et fœtaux d’un dispositif transdermique de trinitrine comparé à la ritodrine IV pour la tocolyse.
Méthodes : 60 femmes présentant une MAP, recrutées dans cette étude qui faisait partie d’une étude multicentrique sur la TNT. Une fois randomisées, les patientes recevaient soit de la TNT en dispositif transdermique, soit de la ritodrine IV e cas de MAP. Les mesures réalisées étaient le pouls maternel, la TA, le RCF enregistrés pendant 24heures et comparés au cours du traitement.
Résultats : La FC maternelle moyenne était diminuée de 21,1bpm en moins (15,7-26,5) dans le groupe TNT. Le FC fœtale était réduite de 9,2bpm en moyenne (3,8-14,6) . La TA moyenne était significativement réduite dans le groupe ritodrine (p=0,003) mais la TA moyenne n’était pas significativement différente au cours du traitement
Aux doses nécessaires pour tocolyser, la TNT percutanée a des effets minimes sur la FC maternelle et fœtale et globalement moins d’effets adverses que la ritodrine. Pour les auteurs, il s’agit d’un traitement plus sûr de la MAP
Note de l'auteur: Ce traitement a beaucoup d’avantages ; il est facile à utiliser, pas cher, relativement efficace (pas moins que les autres tocolytiques) pourtant son utilisation ne semble pas aussi aisée que le montre cet article ; les effets secondaires sont certes moins graves mais ils restent inconfortables ce qui ne permet pas de pouvoir toujours proposer ce produit. Par contre il semble constituer un excellent tocolytique d’urgence en salle de travail en particulier pour régler rapidement et d’une manière peu prolongée (sa demie vie est courte) toute situation d’hypertonie utérine survenant en salle de travail : dans cette utilisation il gagne encore à être connu mais pour moi, il n’offre pas d’avantages assez probant par rapports aux autres anciens tocolytiques.
rôle des cyclo-oxygénases de type i et ii dans la synthèse des prostaglandines dans les membranes en fin de grossesse.
The roles of th cyclo-oxygenases types one and two in prostaglandin synthesis in human fetal membranes at
term. Sawdy RJ, Slater DM, Dennes WJ, Sullivan MH, Benet PR. Placenta 2000 Jan;21(1):54-57.
Le but de cette étude était de déterminer le rôle des cyclo-oxygénases de type I et II (cox I et II) dans la synthèse des prostaglandines à terme.
Méthodes : Les membranes fœtales de 6 grossesses ont été recueillies après césarienne réalisée à terme avant travail. La présence de Cox I et II a été étudiée avec une analyse de type Western. L’influence de Cox I et II était déterminée après incubation des membranes avec un inhibiteur sélectif de Cox I ou de Cox II et une mesure de la libération des prostaglandines sur 24h en utilisant un test de type ELISA.
Résultats : Les protéines Cox I et II ont été trouvées dans l’amnios et le chorion. L’inhibiteur sélectif de la Cox II semble réduire significativement la synthèse des prostaglandines au niveau des membranes à la fois à des concentrations spécifiques o plus élevées. L’inhibiteur de Cox I n’a eu aucun effet sur la synthèse des prostaglandines à des concentrations spécifiques mais peut significativement réduire la synthèse de prostaglandines à des concentrations plus fortes.
Conclusion : Les membranes fœtales contiennent à la fois de la protéine Cox I et II à terme mais seule la Cox II contribue significativement à la synthèse des prostaglandines. Les inhibiteurs de la Cox II sont des drogues efficaces sur la synthèse des prostaglandines par les membranes à terme et sont donc susceptibles de renter en jeu dans la stratégie thérapeutique des MAP.
Note de l'auteur: Certes dans l’éprouvette on est pas tout près du lit de la patiente, pourtant, certains auteurs ont essayé les nouveaux inhibiteurs de type Cox II dans la MAP (publication à propos d’un cas par le même auteur) et ils semblent avoir un effet susceptible de retarder le début du travail. Bien sûr des essais thérapeutiques manquent et l’étude des effets adverses sur le bébé reste à faire mais ces médicaments pourraient peut être s’utiliser dans un avenir proche dans le traitement de la MAP.
ANTAGONISTE DES REcepteurs à l’ocytocine dans le traitement de la Map : étude randomisée en double aveugle contre placebo.
An oxytocin receptor antagonist (atosiban) in the treatment of preterm
labor: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial with tocolytic
rescue. Romero R, Sibai BM, Sanchez Ramos L, Valenzuela GJ, Veille JC, Tabor B, Perry KG, Goodwin
TM, Lane R, Smith J, Shangold G, Creasy GW. Am J Obstet Gynecol 2000 May; 182(5):1173-1183.
Objectif : Cette étude a été mise en œuvre pour déterminer l’efficacité et la sécurité d’un traitement antagoniste des récepteurs à l’ocytocine (Atosiban) dans le traitement des MAP.
Protocole de l’étude : Etude multicentrique en double aveugle contre placebo. Cinq cent trente et une patientes inclues ont été randomisées pour recevoir et 501 ont reçu soit de l’Atosiban (n=246) soit un placebo (n=255) suivi par un maintien du traitement par voie sous cutanée. Les tocolytiques habituels ont été choisis comme sécurité pour traiter après une heure le travail prématuré s’il continuait.
Résultats : Il n’y a pas de différence significative pour le moment de l’accouchement entre les patientes recevant de l’atosiban ou un placebo (médiane=25,6 jours). Le pourcentage de patientes n’ayant pas accouché et n’ayant pas eu besoin d’un autre traitement tocolytique étaient plus nombreuses dans le groupe Atosiban que dans le groupe contrôle (p=0,008). Une différence dans l’efficacité existe en fonction du terme du traitement : L’atosiban a une efficacité supérieure à celle d’un placebo après 28SA. Quatorze patientes ont été randomisées donc 5 traitées par placebo pour un traitement fait avant 24SA : l’incidence des morts fœtales restait supérieure dans le group traité par l’Atosiban. Les effets adverses maternels semblaient comparables dans les deux groupes.
Conclusion : L’atosiban semble prolonger la durée de la grossesse de plus de 7 jours pour un terme supérieur à 28SA et donne peu d’effets secondaires maternels ou fœtaux. Pour un terme supérieur ou égal à 28SA, la morbidité maternelle et fœtale étaient comparables dans les deux groupes. Pour les auteurs, ce traitement peut être proposé dans la prise en charge des MAP à membranes intactes. L’efficacité pour les grossesses d’un terme inférieur à 28 semaines reste encore à démontrer.
Note de l'auteur: Grande étude multicentrique certes mais dont la puissance et les conclusions sont nettement réduites par un choix de protocole
thérapeutique particulier. En effet, les auteurs n’ont pas bien standardisé la définition des MAP et l’on peut penser que tout le monde n’a pas traité la même chose ; par ailleurs aucune équipe n’a renoncé à utiliser ses thérapeutiques habituelles (probablement variables d’un centre à l’autre) si bien que l’on n’est pas en mesure d’affirmer que les effets secondaires observés (en particulier pour les termes inférieurs à 24 SA) sont liés à l’Atosiban (on peut penser que si des équipes utilisent par exemple des bétamimétiques à haute dose en cas d’échec de l’atosiban, il est logique d’observer davantage de problèmes dans le groupe atosiban sans pour autant une efficacité supérieure sur le terme dans ce groupe). Des travaux ont comparés ce produit en double aveugle contre les bétamimétiques et dans notre équipe, la prescription de ce traitement est devenue répandue depuis sa sortie à la fin de l’année dernière : l’efficacité semble tout à fait correcte et au moins équivalente à celle des béta-mimétiques. Par contre les contre indications, les effets indésirables et les arrêts ou réduction de traitement pour intolérance sont beaucoup plus rares qu’avec les bétamimétiques. L’Atosiban est un produit intéressant dans la prise en charge aiguë de la MAP, il est efficace, bien toléré et a peu d’effets secondaires : son principal inconvénient à l’heure actuelle reste son prix très nettement supérieur aux thérapeutiques usuelles.
|